dimanche 28 mars 2010
Les lois objectives du capitalisme
On dit que le marxisme « objectiviste » — celui de la deuxième internationale, hérité parmi d'autres par les « communistes de gauche » — se trompe en liant l'avènement du socialisme à l'inévitable effondrement économique du capitalisme. Selon les critiques, le capitalisme ne s'effondrera jamais de lui-même. Nous pouvons accepter cette conclusion, mais qu'est ce qu'elle implique ?
La réaction classique des révolutionnaires a été de dire qu'accepter que le moment « de l'épuisement de la capacité du mode de production capitaliste à développer les forces de production (...) n'arrivera jamais », c'est ouvrir la porte au réformisme : si le capitalisme ne va jamais s'effondrer et peut toujours développer les forces de production, autant accepter de vivre avec en essayant d'en arrondir les angles.
Toutefois même s'il n'y avait aucune raison « objective » pour que le capitalisme s'effondre économiquement, il ne s'ensuit pas que le fonctionnement du capitalisme en tant que système économique n'est pas réglé par des lois « objectives ». Basé sur l'exploitation du travail salarié et orienté vers l'accumulation du capital de la plus-value extraite du travail des salariés, il ne peut jamais fonctionner comme système produisant pour satisfaire les besoins des gens, mais seulement comme système où la priorité doit toujours être donnée à la recherche des profits. Les réformistes se trompent en croyant pouvoir le faire fonctionner pour le bien de tous.
Rejeter toute « objectivité » dans le fonctionnement du capitalisme, comme semblent faire certains « marxistes autonomes », mène effectivement au réformisme puisque c'est suggérer que tout (enfin, beaucoup) est possible si seulement la classe salariée lutte assez résolument. Ils disent que « tout est lutte de classe » en imaginant que les salariés peuvent par leur lutte « suspendre la loi de la valeur ». Toni Negri parle de « l'autovalorisation ouvrière » (la fixation de leurs salaires par les salariés eux-mêmes en fonction de leur combativité). Mais ce n'est pas vrai. Les salariés peuvent bien entendu influer sur le prix de leur force de travail (il n'y a pas quand même « une loi d'airain de salaires ») mais leur marge de manœuvre est assez étroite. Sinon, les réformistes et les « possibilistes » auraient raison. C'est en ce sens que les « marxistes anti-objectivistes » ouvrent la porte au réformisme.
Ainsi Negri lui-même a fini par proposer un revenu garanti versé inconditionnellement à tous (le « revenu de citoyenneté » d'André Gorz et des Verts) comme quelque chose de réalisable dans le cadre du capitalisme. Bien entendu, ça ne l'est pas. Précisément parce que ça va à l'encontre des lois « objectives » du fonctionnement économique du capitalisme (ça coûterait trop cher aux capitalistes en termes d'impôts, et quelle serait la motivation d'aller travailler pour eux si l'État vous versait un revenu de droit ?). Il faut accepter, donc, que même s'il n'y a aucune loi économique « objective » de l'effondrement inévitable du capitalisme, il existe quand même des lois « objectives » réglant son fonctionnement en tant que système économique. Ni l'action gouvernementale, ni les manifestations de masse, ni la lutte ouvrière (même la plus résolue), ne peuvent changer le fait que le capitalisme ne peut fonctionner dans l'intérêt de tous. Ça, c'est un fait « objectif » et incontournable.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)



















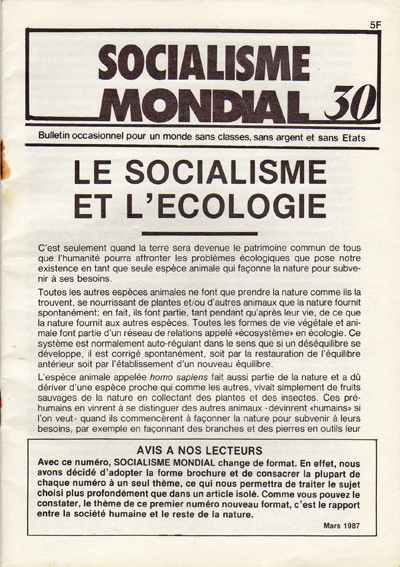
3 commentaires:
La crise, moteur du capitalisme
partie 1
L’histoire du capitalisme se confond avec l’histoire de ses crises. Sur la période 1970-2007, on ne compte pas moins de 124 crises bancaires, 208 crises de change et 63 crises de la dette souveraine ! Même si la plupart d’entre elles restent limitées à des pays périphériques, cela n’en demeure pas moins un constat très impressionnant.
Devant de tels chiffres, l’idée d’une autorégulation par les marchés apparaît comme insuffisante. Pour comprendre comment le capitalisme gère ses excès, il semble que l’hypothèse alternative d’une régulation par les crises ne manque pas d’arguments. Pour s’en convaincre, il n’est que de considérer ce qu’on nomme les « grandes crises » ou crises structurelles. Parce qu’elles sont des périodes de profonde mutation, leur rôle dans l’évolution historique du capitalisme est crucial. La plus célèbre d’entre elles est la Grande Dépression (1929-1939).
Il s’agit de crises profondes, non seulement quantitativement par leur intensité, mais également qualitativement par l’ampleur des transformations institutionnelles qu’elles initient. Ces crises ont pour origine l’épuisement d’un modèle de croissance qui ne réussit plus à contenir ses déséquilibres. Pour repartir, le système économique a besoin de nouvelles règles du jeu, de nouvelles institutions, de nouveaux compromis. Tel est l’enjeu des grandes crises : réinventer un nouveau modèle de croissance.
Ainsi, au cours de la période 1929-1945, le capitalisme a-t-il dû se transformer en proposant un projet original, fondé non plus sur la concurrence à tout-va, mais sur une adéquation permanente, centrée sur la grande entreprise industrielle, entre augmentations du salaire réel, gains de productivité et croissance. Pour désigner ce modèle qui émerge au sortir de la seconde guerre mondiale, on parle de « régulation fordienne, » par référence à Henry Ford, qui avait compris que, pour pouvoir vendre ses automobiles et faire des profits, ses ouvriers devaient être bien payés.
partie 2
Après avoir conduit à une exceptionnelle prospérité, connue sous le nom des « trente glorieuses » (1945-1973), le régime fordien entre, à son tour, en crise. C’est la stagflation des années 1970 (1973-1982), qui mêle d’une manière inédite inflation et croissance faible. Si cette grande crise diffère de celle de 1929, sa signification reste identique : la fin d’une époque et l’avènement d’une nouvelle forme de capitalisme. En conséquence, après la stagflation, au début des années 1980, émerge le capitalisme financiarisé, encore appelé « capitalisme patrimonial » ou « capitalisme néolibéral.«
La rupture avec le régime antérieur est prodigieuse, particulièrement par l’ampleur que connaît la dérégulation financière. On assiste au démantèlement progressif du cadre réglementaire qui, fait notable, avait conduit à l’élimination de toute crise bancaire durant la période fordienne, entre 1945 et 1970. Politiquement, c’est l’arrivée au pouvoir des gouvernements libéraux de Margaret Thatcher au Royaume-Uni (mai 1979) et de Ronald Reagan aux États-Unis (janvier 1981) qui marque le début de cette nouvelle phase. Mais, du point de vue de la régulation économique, l’origine de ce nouveau capitalisme est à trouver dans la transformation révolutionnaire que connaît la politique monétaire. Désormais, l’inflation devient la cible prioritaire.
Pour la combattre, Paul Volcker mis à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 1979 procède à une augmentation étonnante du taux d’intérêt à court terme, jusqu’à atteindre 20 % en juin 1981. Cette politique engendre une mutation complète et définitive du rapport de forces entre débiteurs et créanciers au profit de ces derniers. Désormais, les possesseurs d’actifs financiers ne risquent plus de voir leur rentabilité rongée par l’inflation. Ils ont le champ libre. C’est le début d’une période de vingt-cinq ans qui a pour caractéristique centrale de placer la finance de marché au centre de la régulation, bien au-delà de la seule question technique du financement. Pour le dire simplement, ce sont les marchés financiers qui contrôlent désormais les droits de propriété, ce qu’on n’avait jamais connu auparavant.
partie 3
Dans les capitalismes antérieurs, la propriété du capital s’exerçait sous la forme du contrôle majoritaire au sein de structures spécifiques hors marché, à l’exemple de la Hausbank allemande ( »banque maison« ) ou du contrôle familial. Le représentant emblématique du capitalisme patrimonial est l’investisseur institutionnel. Il est porteur d’une nouvelle gouvernance des entreprises, centrée sur la « valeur actionnariale.«
La crise qui débute en août 2007 doit, selon nous, être comprise comme marquant l’arrivée aux limites du capitalisme patrimonial et son entrée en grande crise. Comme les capitalismes précédents, il succombe lorsque le principe même de son dynamisme se retourne contre lui pour devenir source de déséquilibres. En l’occurrence, c’est la question financière qui s’avère déterminante. Le capitalisme patrimonial ne réussit plus à contrôler l’extension de son secteur financier, dont le poids devient handicapant à partir d’un certain seuil.
Pour le voir, considérons l’endettement total des États-Unis, tous secteurs confondus. Entre 1952 et 1981, durant la période fordiste, sa croissance reste modérée : de 126 % à 168 % du PNB. Pendant la phase néolibérale, ce même ratio explose, pour atteindre 349 % en 2008 ! De même pour le total des actifs financiers des Etats-Unis. Il reste stable de 1952 à 1981, entre 4 et 5 fois le PNB, pour se mettre ensuite à croître jusqu’à plus de 10 fois le PNB en 2007. Au niveau mondial, l’observation est identique : le total des actifs financiers, qui vaut 110 % du PNB mondial en 1980, atteint 346 % en 2006.
Si, dans un premier temps, l’expansion financière a participé activement à la formation de la croissance néolibérale, il apparaît qu’aujourd’hui elle est devenue disproportionnée. Pensons que ce secteur s’approprie 40 % des profits totaux américains en 2007, contre 10 % en 1980, alors qu’il ne représente que 5 % de l’emploi salarié. La démesure est extrême. Elle pèse sur l’ensemble de l’économie par de nombreux canaux. D’abord au travers des exigences de rentabilité. La mondialisation financière des droits de propriété a donné aux actionnaires relayés par les investisseurs institutionnels une puissance inédite. Elle a permis l’émergence d’une norme de rendement aux alentours de 15 % pour les sociétés cotées. Cette exigence de rentabilité est intenable à long terme. Trop peu d’activités industrielles offrent des rendements aussi élevés.
qu'apprendra t'on de cette crise si ce n'est que les produits dérivés puissent être émis en fonction d'une demande réelle et non d'une bourse virtuelle qui rachète l'option d'achat ou de vente. Je crois que cette crise est saine car chaque crise fait tirer une leçon qui permet au capitalisme de se mettre à jour. Contrairement au socialisme, le bien commun, c'est le consommateur! ce mode de fonctionnement est meilleur que le suffrage universel car chaque achat donne du profit à la compagnie qui a généré un bon produit, lui permettant de l'améliorer.
Le socialisme se fout de la productivité, amputant de ce fait n'importe quel désir d'autonomie et de création qui serait mis de l'avant sur un libre marché.. Ce libre marché qui existe de moins en moins étant contraint par des mesures déloyales de protectionisme.
Comme Ayn Rand disait :
" La seule différence entre le socialisme et le totalitarisme n'est qu'une question de temps. "
Enregistrer un commentaire