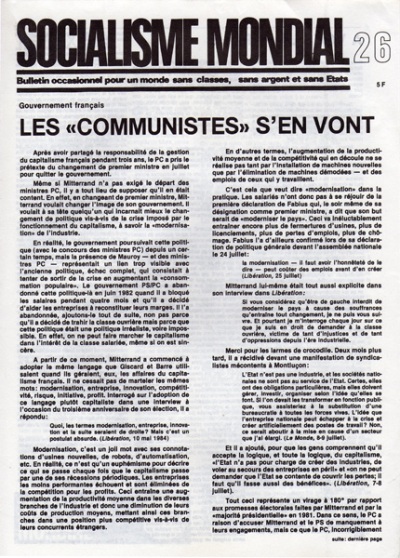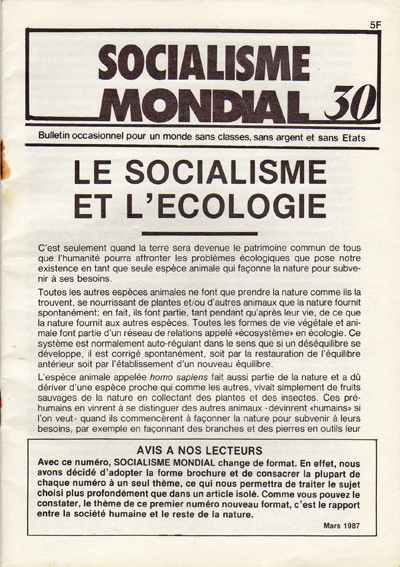Libération (11 octobre 1983) a fait un reportage sur la famine au Brésil. On peut y lire: « La sécheresse dans les états du Nordeste brésilien dure depuis cinq ans » et « à quelques centaines du Nordeste vit le Brésil (...) qui ne peut mais et ne fait rien pour aider ses enfants du nord ». Enfants rendus fous par la faim, génération de nains et de psychotiques à venir.
« Les premiers à mourir furent les animaux domestiques, puis les nouveaux-nés. Aujourd'hui, les survivants attendant leur tour. Survivre, une journée encore, est la seule activité hallucinée des habitants des zones sinistrées. »
Brésil, huitième puissance industrielle de l'Occident, « miracle économique ». Un taux de mortalité infantile de 25 % dans certaines villes. Pourtant: « Les fonds promis par le gouvernement fédéral pour le percement de puits profonds n'ont pas encore été débloqués ». Mais aussi :
« Le premier satellite brésilien est pour bientôt. On se bouscule au portillon - mais poliment - pour devenir président de la république. Le Fonds Monétaire International, les grandes banques commerciales et les éditorialistes des journaux financiers d'Europe et des Etats Unis conseillent fermement aux Brésiliens de se serrer la ceinture. Pour leur bien ».
L'éditorial conclut ainsi:
« En Europe ou aux Etats-Unis, des montagnes de beurre, de fromage ou de lait dorment sous les glacières, faute de débouchés. Si l'on n'a pas confiance, en Europe, dans les autorités des pays du tiers monde, pourquoi pas une aide directe, d'homme à homme ? Des milliers de bateaux pour le Brésil. »
Pourtant, est-ce vraiment un problème d'« hommes », de « confiance » ? Qui décide ? Et cette solution de court terme, dans l'éventualité où on la laissait se réaliser, que changera-t-elle ?
Ou plutôt, ne faut-il pas poser la question à l'envers: « Comment en arrive-t-on à de telles situations ? ». Qu'est-ce qui empêche la libre circulation et distribution des produits en surplus ici ?
De belles photos dans le numéro d'août 1983 de
Geo. Oui, très colorées. Il s'agit de montagnes de pommes. Rouges, vertes, jaunes, cramoisies, moisissantes. Un bulldozer et une montagne de choux-fleurs. Une benne déversant des tonnes de tomates. Très photogénique, cette nappe rouge, dans les bruns, ce sont des pommes de terre. Ailleurs, des pêches, étendues sur des kilomètres de champs, qui seront enfouies sous terre pendant le labourage. Excellent engrais! La, une dune de poires de la meilleure qualité.
Voilà le paysage français. La raison de ce gaspillage (alors que des gens crèvent de faim au Brésil, ou que, en France même, « 70 % des Français consommeraient plus de légumes et de fruits frais si les prix étaient moins élevés ») ? Eviter (à ce prix-là) la chute des prix. L'industrie agricole n'est pas prête de produire sans profit ou à perte.
Quelques autres chiffres: malgré tous les efforts faits pour écouler cette surproduction via les organisations de bienfaisance, les écoles, les prisons, les colonies de vacances, les hôpitaux, les maisons de retraite, les jardins d'enfants, etc., « pour l'été 1982, ceci ne représentait que 1,5 % seulement des choux-fleurs excédentaires, 0,4 % des tomates, 3,5 % des pêches, 3 % des poires et 1 % des pommes retirées du marché. »
« Toutes productions confondues (denrées végétales ou animales), les excédents européens ont coûte en 1982 plus de 200 milliards répartis en opérations de stockage, de destruction ou d'écoulement à des prix réduits sur les marchés mondiaux (vente à I'URSS) ou nationaux (« beurre de Noël »). »
Comme le remarque
Geo, « donner ces excédents aux peuples qui meurent de faim est impraticable » (impraticable dans notre système):
« les coûts d'acheminement sont extrêmement élevés vers ces pays, qui ne disposent ni d'un réseau routier, ni de capacités de stockage, ni de véhicules utilitaires (...). La note de frais serait assez salée (...).
La distribution gratuite de produits alimentaires provoque dans les pays bénéficiaires un effondrement des cours des produits agricoles. Dans ce cas, ce sont les petits paysans locaux qui sont minés. »
On trouve donc un constat et des faits intéressants dans ce numéro de Geo, mais, une fois de plus, la véritable barrière à la distribution des biens et, plus en amont, de l'existence d'un tiers monde n'est pas élucidée. Et pourtant, la clé qui cadenasse ce système saute aux yeux : le fric.
(
Socialisme Mondial 25, No 1, 1984)