lundi 22 février 2010
L’échec du réformisme
L’amélioration du sort des salariés fut, c’est vrai, avec l’État-providence, l’une des grandes conquêtes du réformisme. La sécurité sociale (d’ailleurs introduite au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale, non par des « socialistes » mais par le gouvernement du Général de Gaulle), la retraite à soixante ans, les congés payés, la réduction du temps de travail, les allocations chômage, etc. représentent des réformes qui ont grandement amélioré les conditions de vie des salariés.
Mais les avancées de la première partie du 20ème siècle font maintenant partie d’une époque révolue. Depuis la crise mondiale des années 1970, qui mit fin brutalement au boom économique d’après-guerre, aucune amélioration significative dans aucun domaine important pour les salariés ou leurs familles (santé, protection sociale, logement, éducation, etc.) n’a été introduite. Pire encore, depuis cette époque, nos acquis sociaux – nos « privilèges » – (sécurité sociale, retraite, allocations chômage, etc.) n’ont cessé d’être les cibles des gouvernements de tous bords.
La raison en est l’intensification de la concurrence sur les marchés mondiaux qui suivit la période « dorée » d’après-guerre (les fameuses « Trente Glorieuses », qui ne furent, d’ailleurs, ni trente ni glorieuses pour tout le monde). Pour permettre à leurs entreprises nationales de rester compétitives, les gouvernements de tous bords furent contraints de prendre des mesures destinées à augmenter les profits et, donc, à diminuer les salaires – relatifs et/ou réels – et les acquis sociaux des salariés.
En effet, les profits réalisés sur le marché sont, non seulement la source de financement des investissements, nécessaires au maintien de la compétitivité et à l’amélioration de la productivité, mais aussi la principale source de revenus des gouvernements. C’est cette situation économique mondiale qui a déclenché les attaques de la classe capitaliste, relayée par ses médias, contre les impôts « trop lourds », les « privilèges » des fonctionnaires, etc. et en faveur d’une réduction du budget – et du personnel – de l’État. Les gouvernements, y compris les gouvernements « socialistes », prisonniers de cette situation internationale, n’ont eu d’autre choix que de s’y plier, mettant fin à l’illusion réformiste.
L’histoire politique et économique de la France, depuis le milieu des années 1970 est en fait l’histoire des moyens adoptés par les gouvernements, de droite comme de gauche, pour réduire les ponctions de l’État sur les profits. Toutes les réductions d’impôts et de taxes payés par les entreprises, supposées « lutter contre le chômage », « préserver la compétitivité de « nos » entreprises », n’ont été, en réalité, que des mesures destinées à accroître la part des revenus financiers au détriment des salaires.
S’il est un fait que le réformisme politique a pu obtenir des avancées pour les salariés (après tout, en tant que salariés nous-mêmes, nous ne pouvons qu’accueillir favorablement la création de la sécurité sociale, la mise en place des congés payés, la réduction du temps de travail ou l’abaissement de l’âge de la retraite), il est non moins indéniable que ces réformes sont toujours sous la menace de leur remise en cause, et ce, sous les prétextes les plus divers et les plus « réalistes » (pour défendre « nos » entreprises face à la concurrence étrangère ; en raison du vieillissement de la population ; à cause du « trou » de la sécurité sociale, etc.), comme le montrent le recul de l’âge de la retraite, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, les baisses des remboursements de la sécurité sociale, la diminution des allocations chômage, etc.
Les capitalistes les plus lucides voyaient, d’ailleurs, un autre intérêt dans les réformes : mieux vaut une main d’œuvre satisfaite et en bonne santé et, donc, plus productive et moins sujette à l’absentéisme. La création de la sécurité sociale, au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale est, de ce point de vue, un cas exemplaire. En effet, malgré les ravages causés par la guerre à l’économie, le gouvernement et le patronat trouvèrent l’argent nécessaire à la mise en place de la sécurité sociale. Aujourd’hui, alors que les richesses produites sont sans commune mesure avec celles créées il y a plus de 60 ans par une économie dévastée, les mêmes prétendent n’avoir plus d’argent pour financer le « trou » de la sécurité sociale. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chômage de masse fournit aux employeurs un tel réservoir de main d’œuvre qu’ils n’ont plus à se préoccuper de notre santé. Si nous tombons malades, d’autres nous remplaceront.
Un autre exemple est constitué par l’abaissement, en avril 1983, de l’âge de la retraite à 60 ans, qui « constitue une grande conquête sociale, espérée depuis la fin du siècle dernier », mais ne faisait qu’abroger une mesure régressive antérieure. En fait, il rétablissait la situation qui existait avant la guerre, grâce à une loi de 1930 qui avait fixé l’âge de la retraite à 60 ans, mais qu’une ordonnance de 1945 (signée par un certain Ambroise Croizat, Ministre « communiste » du Travail et de la Sécurité Sociale) avait quelque peu rogné en diminuant de moitié la pension reçue à 60 ans, obligeant les salariés à travailler au-delà. L’abaissement effectif de l’âge de la retraite en 1983, s’il représente indiscutablement un progrès pour les salariés, répondait, en réalité, à la nécessité d’assainir le marché du travail face à un chômage en progression constante... tout comme son relèvement, en 1945 n’avait été qu’une réponse à la pénurie de main d’œuvre existant à l’époque.
Le réformisme a cessé depuis longtemps d’être un courant du mouvement socialiste et s’est converti en une simple solution de remplacement pour la gestion du capitalisme. Après plus d’un (trop long) siècle de réformisme, une constatation s’impose : ce ne sont pas les partis « socialistes » et travaillistes qui ont graduellement changé – « humanisé » – le capitalisme, mais celui-ci qui a peu à peu changé et déshumanisé les partis réformistes .
L’engagement initial de ces partis (ne serait-ce que verbal) en faveur du socialisme a laissé la place au simple électoralisme, à la poursuite (jamais satisfaite), puis à l’abandon, des réformes, à l’acceptation sans fard du capitalisme et à une gestion gouvernementale difficile à distinguer de celle de leurs « adversaires » de droite.
Au sens où les sociaux-démocrates du 19ème siècle et du début du 20ème l’entendaient, c’est-à-dire en tant qu’améliorations de la condition des travailleurs, des réformes, il n’y en a plus. Tous les partis politiques actuels se déclarent réformistes ou réformateurs, tous proposent des « réformes ». Mais ce qu’ils entendent par là n’a plus rien à voir avec le sens originel de ce terme. Aujourd’hui, tout retour en arrière, toute attaque contre la classe travailleuse, toute suppression ou amputation d’une réforme antérieure, obtenue parfois au prix de longues luttes, de lourds sacrifices et de violentes répressions, est une réforme. Le réformisme issu du courant social-démocrate est mort et enterré.
Les partis réformistes constituent désormais des instruments au service du capitalisme. Tous acceptent – et défendent – l’appropriation privée des moyens d’existence de la société par une petite minorité privilégiée, se faisant, de ce fait, les complices de la domination politique, économique et sociale de cette minorité parasite sur l’ensemble de la société ; tous tentent de nous faire croire qu’il est possible de concilier des intérêts aussi diamétralement opposés que ceux des patrons et ceux des salariés.
Ce qui devrait être une évidence, depuis longtemps, pour les salariés, c’est que le réformisme, parce qu’il ne remet pas en cause le capitalisme, la cause première, pourtant, de tous nos problèmes, et, donc, parce qu’il accepte le risque que les réformes gagnées soient toujours menacées, est une impasse pour eux et une bouée de sauvetage pour la classe dominante.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


















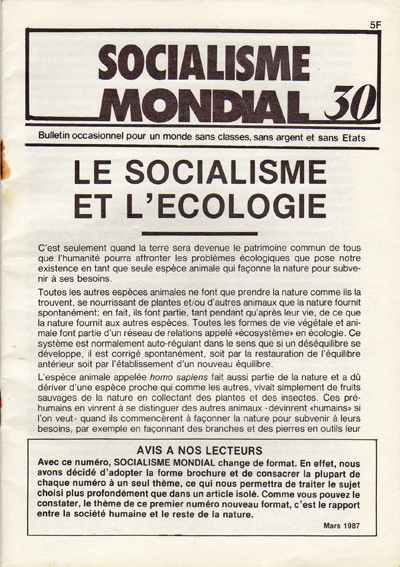
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire